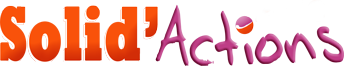Depuis le 1er janvier, 12 suicides et 8 tentatives de suicide sont à déplorer au sein de la DGFiP. Les chiffres déjà dramatiques des années précédentes ont d’ores et déjà été dépassés en seulement quelques mois. Au regard des conditions de travail dans notre administration, Solidaires Finances Publiques s’inquiète profondément de cette situation. Nous attendons une réponse à la hauteur des enjeux humains, professionnels et collectifs qu’ils soulèvent.
Nous savons salué la réactivité dont ont fait preuve certaines directions locales pour accompagner les collectifs de travail et l’engagement de la DG à systématiser les points d’information au sein de la formation spécialisée de réseau, ce qui peut contribuer à une meilleure visibilité de ces situations dramatiques.
Cependant, cette approche, encore trop centrée sur la gestion de crise et l’accompagnement post-événement, reste insuffisante. Il est indispensable d’aller plus loin dans l’analyse des causes, en interrogeant de manière systématique ce qui, dans le travail et dans son organisation, a pu contribuer à la survenue de ces gestes irréversibles. Il ne s’agit pas de désigner un coupable mais de sortir d’une lecture individualisante ou psychologisante. Nous savons, de par notre engagement syndical et notre proximité avec les agent·es, que de nombreuses situations dramatiques comportent une composante professionnelle non négligeable, qu’il s’agisse de surcharge de travail, de conflits hiérarchiques, de perte de sens ou de solitude dans l’exercice des missions. Ce sont trop souvent des pesanteurs qui deviennent des fardeaux et qui atteignent et dégradent la vie privée. La prévention ne peut progresser sans une volonté ferme de mettre le travail sur la table, d’en faire l’objet central des investigations et de dégager collectivement des leviers de transformation.
Nous sommes par ailleurs très surpris qu’en treize années, seuls trois suicides aient été reconnus comme ayant un lien établi avec le travail. Ce chiffre interroge sur les critères utilisés pour établir ce lien et pose la question de la réelle volonté institutionnelle de faire émerger une compréhension fine des conditions de travail ayant pu contribuer à ces gestes.
Nous ne contestons nullement que des facteurs personnels puissent entrer en jeu dans la survenue de tels drames. Chaque situation est singulière, chaque trajectoire individuelle mérite d’être entendue avec respect. Mais que l’administration, dès la survenue de l’évènement, réduise ces drames à des fragilités individuelles est à la fois indécent et préoccupant.
|
Une telle posture revient à nier la part de responsabilité que peuvent avoir l’organisation du travail, les méthodes de management, les choix politiques de restructuration ou encore le manque chronique de moyens. Ce discours, trop souvent répété, empêche de voir ce que le travail fait aux personnes, en particulier à celles et ceux qui y investissent profondément leur énergie, leur conscience professionnelle et parfois leur identité. Refuser d’interroger le rôle du travail dans ces tragédies, c’est tourner le dos à toute politique de prévention digne de ce nom. C’est aussi faire peser sur les agent·es le poids d’une souffrance qu’ils n’ont pas à porter seuls.
De même, nous regrettons que la réponse de l’administration reste largement centrée sur l’accompagnement psychologique post-événement. Ce type d’intervention, s’il peut être utile à court terme, ne saurait tenir lieu de politique de prévention. Ce qui est en cause, c’est aussi et surtout l’organisation du travail, les conditions d’exercice des missions, l’isolement des agent·es dans des collectifs affaiblis, la pression sur les résultats et l’absence d’espaces de régulation du travail. Nous ne pouvons nous satisfaire d’une prévention construite uniquement sur la remédiation individuelle. Se réparer, se renforcer, restaurer ses « ressources individuelles » pour mieux repartir dans le système qui vous a broyé, à quoi bon si ce système n’a pas été remis en cause ? La prévention doit se faire dans une approche collective, structurelle et ancrée dans la réalité du travail tel qu’il se fait au quotidien.
Il ne suffit plus d’accompagner après coup. Il ne suffit plus de dire que l’on est attentif, que l’on a à cœur d’être vigilant au bien-être des agent·es. Il est temps que l’administration assume pleinement sa responsabilité et sorte de l’évitement. Nous exigeons la mise en place d’une politique de prévention à la hauteur des enjeux, qui cesse de détourner le regard du travail réel, de ses impasses, de ses violences silencieuses.
Cela suppose du courage politique une volonté affirmée de remettre en débat l’organisation du travail elle-même et de tirer les conséquences des restructurations incessantes que les personnels de la DGFiP subissent depuis sa création. Ce n’est qu’ainsi que l’on pourra espérer faire de la santé au travail autre chose qu’un affichage.
|
![]() 20250708_FSm_liminaire_def.pdf
20250708_FSm_liminaire_def.pdf