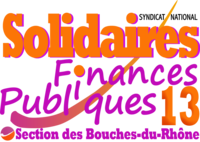Interview d'Annick COUPE, ancienne porte-parole, de 2001 à 2014, de l’Union syndicale Solidaires. Ballast, 28/07/2018.
Annick Coupé : « Le syndicalisme est un outil irremplaçable »
Un café proche de la Bourse du Travail, à Paris. La radio passe « Le Sud » de Nino Ferrer ; Annick Coupé commande du vin. Celle qui fut tour à tour caissière, institutrice et employée de La Poste a également été cofondatrice de SUD-PTT et ancienne porte-parole, de 2001 à 2014, de l'Union syndicale Solidaires (forte, à sa passation de flambeau, de 110 000 adhérent.e.s) : c’est à ces titres que nous tenions à la rencontrer. Le déclin du taux de syndicalisation est un marronnier de la presse française (11 % des travailleurs, en 2013) ; les raisons avancées sont multiples : désindustrialisation, précarisation, discontinuité des parcours professionnels, montée du chômage, individualisation et mise au pas capitaliste des imaginaires. Mais c’est d’institutionnalisation dont nous discuterons tout en revenant sur le parcours personnel de cette militante féministe de longue date : comment maintenir un syndicalisme combattif et soucieux de ne pas parler à la place des salarié.e.s ?
Quand commence votre engagement ?
Je suis d’une famille de petits commerçants de milieu rural, plutôt gaullistes, sans être trop à droite. J’étais la plus jeune de quatre enfants ; mes frères et sœurs ne sont pas du tout engagés. Mon engagement commence en 1968, en seconde. Dans mon lycée de Normandie, un mouvement s’était initié : j’y ai participé sans réellement en avoir conscience. Je me souviens très bien du moment où les élèves de terminale sont passés dans les classes pour nous demander nos revendications ; deux choses étaient sorties : de meilleures conditions — notamment au foyer lycéen — et des cours d’éducation sexuelle. C’est assez représentatif de ce qu’était la société à ce moment-là, avec des jeunes étouffant dans une société conservatrice. Ensuite, j’ai été déléguée de classe, tout en étant confrontée à des problèmes de discipline. Par exemple, ils avaient installé un gros tissu séparant la salle de permanence en deux, avec d’un côté les filles et de l’autre les garçons ; je n’ai rien trouvé de mieux que de faire des trous dedans et de marquer « À bas le mur ! ». J’ai risqué l’exclusion. Il y avait chez moi une certaine révolte par rapport à l’institution. J’ai eu mon bac à 18 ans ; c’était trop tôt pour intégrer une école de journalisme (je voulais être correspondante de guerre), donc je me suis inscrite en lettres modernes avec l’idée que j’intégrerai plus tard ladite école. À l’automne 1970, je suis entrée à la fac de Caen. 15 jours après la rentrée, celle-ci était en grève ! Il y avait toute la palette des groupes d’extrême gauche : des maoïstes, des marxistes-léninistes, des maoïstes spontanéistes, des trotskystes et un groupe qui s’appelait VLR (Vive la révolution). D’emblée, j’ai trouvé ça bien. Je suis entrée en grève, comme tout le monde, et je n’ai jamais repris mes études : j’ai passé mon année à traîner avec ces groupes d’extrême gauche et à faire des actions. Ça a été une année de découverte totale en même temps que de politisation, aussi bien sur les rapports de classe que la situation internationale, notamment le Viêtnam.
« Dans ma cellule, on avait appris qu’un ouvrier frappait sa femme : avec des camarades, on voulait réagir mais on nous a dit de nous taire, de ne pas parler de ça. »
En septembre 1971, je suis revenue à Caen ; j’ai retrouvé des copains dans un groupe maoïste, le Parti communiste marxiste-léniniste de France (PCMLF). Ils m’ont proposé d’adhérer, ce que j’ai fait. L’idée, c’était que je m’engageais pour la révolution. Il fallait remplir un questionnaire dans lequel on nous demandait si on était prêt à mourir pour elle : j’ai répondu « oui » sans aucun problème. C’est assez désuet, aujourd’hui, mais c’était l’ambiance ! J’étais une activiste, avant tout, assez réticente quant aux grands débats sur le marxisme… Puis j’ai cherché un boulot, j’ai pris mon indépendance financière. J’ai tenté de m’établir1 en usine, mais je diffusais des tracts toutes les semaines devant celle du coin, donc le recrutement était un peu compliqué… Finalement, j’ai réussi à me faire embaucher comme caissière dans l’un des premiers hypermarchés de France. J’y suis restée quatre ans. C’est là que j’ai pris mon premier engagement syndical. Dans les années 1977 et 1978, mon organisation devenait beaucoup moins spontanéiste et beaucoup plus dogmatique : elle était davantage tournée vers la classe ouvrière et délaissait les étudiants. Après la mort de Mao Tse Tung et la prise de conscience de ce qu’il se passait en Chine, j’ai eu le sentiment que ce soutien inconditionnel devenait de plus en plus problématique. J’ai donc quitté cette organisation.
Un autre élément qui a beaucoup joué, ça a été la question du féminisme. Les mouvements des femmes émergeaient alors partout. J’ai participé aux groupes de défense du droit à l’avortement du Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC) — j’ai d’ailleurs dû aller en Angleterre pour avorter —, sans toutefois m’engager vraiment. Mais je sentais ces enjeux et voyais qu’ils n’étaient pas considérés à leur juste valeur au sein de mon organisation : il y avait cette idée que c’était un mouvement de petites bourgeoises, que l’important était la contradiction principale, c’est-à-dire Capital/Travail. Et ça avait des répercussions concrètes ! Dans ma cellule, on avait appris qu’un ouvrier frappait sa femme : avec des camarades, on voulait réagir, mais on nous a dit de nous taire, de ne pas parler de ça, que ce n’était pas essentiel. Même si je ne le formalisais pas, ça m’avait perturbée. Quand je suis arrivée à Paris en 1976, il y avait des militantes maoïstes qui, elles, étaient engagées dans des groupes féministes. J’ai vu assez vite que c’était très compliqué. Ça a fait partie de ma prise de conscience : petit à petit, entre mon engagement syndical, mes expériences féministes et le PCMLF, l’écart s’est creusé. Depuis mon départ de ce parti, je n’ai plus eu d’autre appartenance dans une organisation politique. J’ai considéré que mon engagement syndical suffisait amplement, d’autant que ce n’est pas seulement un engagement syndical de défense immédiate des salariés mais un syndicalisme très ouvert, de transformation sociale. C’était une période de grande ouverture sur le monde, de découverte d’importantes contradictions. Je suis très contente d’être passée par là — tout en gardant en tête les limites et les défauts de cette période et de ces organisations politiques.

Comment avez-vous, sur la base de cette prise de conscience, noué ensuite ces deux engagements, anticapitaliste et féministe ?
Je suis venue au féminisme avant même d’entrer aux PTT. Dans chaque organisation syndicale que je côtoyais, nous organisions une commission femmes. Cet engagement s’est fondé sur l’idée que les inégalités vécues par les femmes au travail sont liées à celles qu’elles vivent dans l’ensemble de la société, y compris dans la sphère privée. S’il existe encore une tolérance sociale en matière d’inégalité de salaires, c’est bien parce qu’on se situe toujours dans cette vieille idée qu’une femme n’est jamais totalement autonome : ce n’est pas grave si elle n’a pas son autonomie financière. En novembre 1995, il y a eu une importante mobilisation sur le droit à l’avortement. On s’était donc dit, avec des copines syndicalistes, que ce serait bien d’essayer d’organiser un événement : les premières Journées intersyndicales femmes datent de 1997 — une journée réunissant différents syndicats : FSU, SUD-PTT et quelques camarades de la CGT. Nous étions une cinquantaine à la Bourse du Travail de Paris ; cette année [2018], nous étions 450 personnes : c’était blindé ! Quels que soient les syndicats, et malgré leurs différences, nous sommes confrontées à des difficultés similaires en tant que femmes — notamment celle de la prise en compte de la question féministe au sein de nos organisations. À la fin de ces journées, nos copines nous disent à chaque fois qu’elles sont regonflées, que c’est une grande bouffée d’air frais. C’est vrai que ça motive de se rencontrer, de parler de nos obstacles et de nos avancées. Ces journées ont contribué à ce que, dans ces trois organisations syndicales, les choses changent. Alors qu’on présente parfois les questions féministes comme de la diversion, ces journées nous ont rapprochées !
« Comment veux-tu que les femmes se reconnaissent dans le mouvement syndical si elles n’y voient que des hommes ? »
Dans un syndicat, la lutte féministe se fait évidemment à tous les niveaux. Celui des revendications de base (à travail égal, salaire égal), mais au-delà : il faut penser nos revendications avec ce qu’on appelle des « lunettes de genre ». Par exemple, la réorganisation des services dans une entreprise n’aura pas forcément les mêmes conséquences pour les hommes et pour les femmes. La question des horaires de début et de fin — l’amplitude de la journée — n’est pas vécue de la même façon si on doit garder des enfants en rentrant chez soi. Il faut être conscients de ces mécanismes dans nos revendications. Au niveau national, il est important d’avoir des têtes féminines. Qu’on le veuille ou non, les images comptent. Comment veux-tu que les femmes se reconnaissent dans le mouvement syndical si elles n’y voient que des hommes ? Mais il faut faire attention : j’ai longtemps été porte-parole de Solidaires ; j’étais souvent la seule femme dans les premières lignes des manifestations ; j’étais un peu l’arbre qui cachait la forêt… J’ai toujours expliqué que la lutte féministe était bien plus complexe que ça : il ne suffit pas d’une femme à la tête pour tout régler ! Ce travail se fait donc autant au niveau local que national. Je raconte toujours — et c’est un peu méchant — que, dans une réunion, lorsqu’un homme part à 17 heures pour chercher ses enfants, il le dit, et tout le monde le note. Lorsque c’est une femme, elle ne dit rien parce que c’est imprégné dans la société. Le syndicalisme n’est pas en dehors de la société, il est traversé par les mêmes tensions et les mêmes contradictions. Mais je continue de penser qu’on devrait être un petit peu plus exemplaires que la société.
Vous avez vécu en première ligne la création de SUD-PTT puis de l’Union Syndicale Solidaires. Quel était alors le besoin de créer une organisation syndicale supplémentaire ?
J’ai adhéré à la CFDT en 1972, quand j’ai commencé à travailler. Pour bien des gens d’alors, c’était le côté autogestionnaire qui comptait véritablement. Pour moi également. Mon adhésion s’est aussi faite en opposition à une CGT à l’époque très marquée par son lien avec le Parti communiste français. La création de SUD-PTT démarre à l’automne 1988 : j’étais à ce moment-là postière au service financier de La Poste, à Paris, et responsable de la CFDT-PTT de l’Île-de-France. Avec certains militants, nous étions dans ce qu’on pourrait appeler l’opposition à la ligne nationale de la Confédération, dirigée par Edmond Maire. Il y avait des débats tendus mais on pensait qu’on pouvait rester dans la CFDT, s’opposer, être minoritaires et continuer à faire le syndicalisme qu’on voulait, bref, qu’on pouvait coexister au sein de la même organisation. À l’automne 1988, deux conflits vont jouer un rôle essentiel. D’abord, celui des hospitaliers et plus précisément des infirmières. C’était un milieu peu syndiqué ; or, là, il y avait un gros mouvement social, avec des grèves, des actions et des manifestations, ainsi qu’une coordination d’infirmières réunissant des syndiqués et des non-syndiqués. Cette forme d’organisation partait de l’idée que ce sont celles et ceux qui sont en grève et qui sont directement concernés qui doivent prendre les décisions dans la lutte. Les coordinations existaient déjà, notamment avec celles des cheminots en 1986, mais celles de la santé ont donné une ampleur importante au mouvement. Ensuite, il y a eu le mouvement des « camions jaunes » à La Poste. C’étaient ces camions jaunes qui transportaient le courrier entre les centres de tri et les bureaux de poste. Là encore, le mouvement a démarré avec une coordination regroupant syndiqués et non-syndiqués décidant eux-mêmes des modalités de la lutte.

Au sein de la CFDT, le secteur de la santé soutenait la coordination des infirmières et le secteur PTT soutenait les camions jaunes. C’est là que nous avons eu une vraie rupture avec la direction nationale. Celle-ci affirmait que les coordinations étaient des outils anti-syndicaux, qu’ils affaiblissaient nos organisations et qu’il ne fallait pas les soutenir. Pendant ce temps, la situation chez les camions jaunes se détériorait : le ministère des PTT refusait d’ouvrir les négociations, espérant que le mouvement s’arrêterait de lui-même. Manque de chance, il s’est étendu et durci, avec des blocages de centres de tri. Au bout de trois semaines, le ministère a ouvert les négociations. En tant que responsable régionale, j’ai participé à ces négociations. Un jeudi soir, on s’était quittés avec le reste de la CFDT en se donnant rendez-vous le lendemain pour finir les négociations ; le lendemain matin, j’entendais à la radio que la CFDT appelait à la reprise du travail, sans même en parler avec les militants, et encore moins avec les grévistes ! Nous avons immédiatement dénoncé cette décision et rappelé que c’était aux salariés de décider de leur lutte. Mine de rien, c’était une décision difficile à prendre… Tout cela s’est cristallisé la même année au moment du Congrès confédéral de Strasbourg. Au cours de son intervention, Edmond Maire a lancé « Il y a des personnes qui n’ont plus leur place à la CFDT, il y a des moutons noirs » ; lorsque je suis intervenue, j’ai été huée et interrompue. Trois jours plus tard, nous étions convoqués, nous les responsables des PTT-Paris, par la Fédération CFDT-PTT, pour nous informer que nous n’étions pas formellement exclus (les statuts ne le permettant pas) mais qu’on nous enlevait nos mandats. Ils ont fait la même chose à la santé. On a perdu tous nos moyens : plus de local ni de moyen d’imprimer des tracts. Ce fut un coup dur. On avait été élus par nos adhérents : on l’a vécu comme un coup de force anti-démocratique.
« On a perdu tous nos moyens : plus de local ni de moyen d’imprimer des tracts. On avait été élus par nos adhérents : on l’a vécu comme un coup de force anti-démocratique. »
Le soir même, on s’est réunis avec nos différents adhérents et on a décidé de créer un nouveau syndicat. Fin décembre 1988, on a déposé les statuts avec l’idée qu’il était peut-être encore possible de revenir à la CFDT : on voulait montrer qu’on avait vraiment franchi le pas mais qu’on était prêts à dissoudre notre syndicat s’ils retiraient leurs sanctions. On a cherché un nom… On a trouvé « SUD » : Solidaire, Unitaire, Démocratique. Je n’étais pas très convaincue mais on devait faire vite. Avec le temps, on s’est dit que c’était un bon coup de communication : ce nom est facile à mémoriser — les sigles syndicaux sont parfois bien compliqués… — et, à cette époque, les gens qui débutaient leur carrière sur Paris venaient souvent du sud de la France (c’est d’ailleurs un camarade toulousain qui a trouvé le nom). En parallèle, on avait une autre échéance importante : les élections professionnelles dans les Télécoms en mars 1989. Si la CFDT maintenait ses sanctions, on pensait donc présenter notre propre liste. C’est ce qu’on a fait, puisque la CFDT n’a pas bougé d’un fil. Et ça a plutôt bien marché : à Paris, on a fait 15 %, dans mon service, 20 % : c’était énorme !
Et pourquoi n’avoir pas rejoint FO, voire même la CGT ?
FO, ce n’est pas notre type de syndicalisme… Quelques militants de chez nous avaient déjà été à la CGT et avaient été plus ou moins écartés. Comme je le disais, la CGT était alors très stalinienne : on ne se sentait pas d’y aller. On voulait continuer le syndicalisme qu’on faisait à la CFDT et on savait qu’on ne le pouvait pas au sein de la CGT. D’ailleurs, elle a sorti des tracts, à ce moment, pour dire que SUD était une pure création de la CFDT en vue d’affaiblir la CGT. Notre pari était assez audacieux : les PTT représentaient alors 450 000 personnes — un gros secteur de la fonction publique.
Vient ensuite la rencontre avec le Groupe des Dix…
Tout à fait. En 1981, à l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand, un syndicat de l’aérien avait contacté d’autres syndicats automnes : ils furent dix à répondre à l’appel puis à se réunir de façon régulière. Au début, il s’agissait d’un club informel. Ces syndicats « autonomes2 » avaient décidé de se rassembler pour pousser le gouvernement à respecter leurs revendications. Ils ont rapidement pris contact avec la CGT, la CFDT et FO : tous leur ont répondu d’entrer plutôt dans leur syndicat… Dès le mois de janvier 1989, au moment de la création de SUD, l’un des fondateurs de ce Groupe des Dix, Gérard Gourguechon, nous a contactés. Ils avaient lu notre histoire dans la presse, nous avaient trouvé combatifs et voulaient nous voir. Au début, on était assez réservés : venant de la CFDT, les syndicats non affiliés étaient à nos yeux quasiment tous des jaunes ! Les interventions et le travail de Gérard Gourguechon ont été très importants de ce point de vue. Au même moment débutait une grève très radicale aux impôts. Les gens payaient en chèque — il n’y avait pas de prélèvements — et le syndicat de Gérard a décidé de piquer les chèques pour les garder pendant plusieurs mois. Ils ont fait la preuve de leur combativité : ça a beaucoup contribué à changer l’image qu’on avait de ces syndicats autonomes. On voyait qu’ils étaient comme nous, des syndicalistes qui se battaient, se confrontaient même au gouvernement socialiste — alors que, traditionnellement, les salariés aux impôts votaient PS. Ils étaient confrontés à un pouvoir qui ne les écoutait pas : ça les a radicalisés. En parallèle, à la création de SUD-PTT, on avait inscrit dans nos statuts qu’on ne voulait pas rester un syndicat exclusivement réservé aux PTT. On venait d’une Confédération : l’interprofessionnel était très important pour nous. C’est ainsi que SUD-PTT a très vite intégré le Groupe des Dix, en se disant qu’on n’avait rien à perdre à aller avec eux. Notre relation est d’abord restée assez informelle : on se réunissait régulièrement, on s’entraidait, mais sans obligations.

Comment êtes-vous parvenus à composer avec cette hétérogénéité et à construire un seul et même outil accepté et partagé par tous ?
L’histoire de SUD-PTT et de Solidaires s’est construite au fil des mobilisations et des conflits sociaux. Développer un nouvel outil syndical interprofessionnel à partir d’histoires différentes était un vrai pari. On voulait tenter de prendre le meilleur de chaque tradition syndicale. Ça a été un travail long et progressif. La mobilisation de 1995 a été décisive : c’était le plan Juppé, avec une immense mobilisation aux mois de novembre et décembre. Entretemps, on était passés à 17 organisations dans le Groupe des Dix. Tous, sans exception, avec nos histoires différentes, étions du bon côté : contre le gouvernement. Ce mouvement terminé, une partie des cheminots a décidé de quitter la CFDT pour constituer SUD-Rail, en 1996. La même année s’est créé SUD-Éducation. Dans les deux cas, ce sont les militants qui ont décidé de partir de la CFDT, en opposition avec la ligne défendue par Nicole Notat, à savoir le soutien d’un gouvernement de droite ! Ça a créé des discussions voire des tensions avec les membres historiques du Groupe des Dix, mais on a eu collectivement l’intelligence de surmonter cette situation : on devait travailler ensemble. En sont sortis des statuts et des textes fondateurs, puis une période de rodage. Ces statuts font la singularité de Solidaires : un syndicat/une voix, peu importe le nombre d’adhérents. Chaque syndicat a un poids équivalent aux autres. Il y aussi le consensus comme mode de prise de décision et le droit de véto exceptionnel, auquel un syndicat peut recourir afin de s’opposer à une décision qu’il estime contraire aux choix et principes de son syndicat (en 10 ans, je ne l’ai vu appliqué qu’une seule fois).
« On ne peut pas penser ce qui se passe dans le monde du travail (la précarisation, les droits supprimés, les statuts, etc.) sans penser ce qui se passe dans l’ensemble de la société. »
À la CFDT, on était tout le temps minoritaires ; c’est un schéma où la majorité et la minorité sont fixées et où les choses ne bougent pas. On ne voulait plus de ce fonctionnement. Les syndicats autonomes, de leur côté, ne voulaient pas être rattrapés par une confédération qui leur dirait ce qu’ils devaient faire. C’est là-dessus qu’on a fondé le principal consensus de notre organisation. On a déposé les statuts, créant ainsi l’union syndicale interprofessionnelle (elle s’appelait alors « Groupe des Dix », même si on était déjà une vingtaine d’organisations ; trois ans plus tard, on a opté pour le nom « Solidaires »). Là encore, ce travail d’élaboration et de rédaction s’est fait en même temps qu’une mobilisation importante, à savoir les retraites, en 2003. Par nos activités au quotidien, on dessinait peu à peu un syndicalisme résolument tourné vers les mouvements sociaux. On avait participé aux marches des chômeurs avec le mouvement AC !, aux marches européennes contre le chômage en 1998 et à la création d’Attac la même année. On ne peut pas penser ce qui se passe dans le monde du travail (la précarisation, les droits supprimés, les statuts, etc.) sans penser ce qui se passe dans l’ensemble de la société. Le syndicalisme n’a pas la réponse à lui tout seul, ni en termes de rapport de force, ni en termes de projets alternatifs. Aussi, en France, on a une longue histoire de subordination des mouvements sociaux, et en particulier du syndicalisme, vis-à-vis des partis politiques. C’était très important de se sortir de ça. C’est notamment au nom de ça que, durant la décennie mitterrandienne, le syndicalisme s’en était remis aux pouvoirs politiques : le lien avec le mouvement social nous protège de cette mise sous tutelle.
En regardant les chiffres de syndicalisation, en France et de nos jours, on a le sentiment que le déclin est une fatalité. Au premier rang des explications généralement apportées se trouve « l’institutionnalisation » du syndicalisme. Comment le lien avec les institutions est-il devenu un obstacle au travail syndical ?
Si on parle d’institutionnalisation au sens de participation aux élections, il faut savoir que la question de se présenter ou non ne s’est jamais posée chez nous — ce qui ne veut pas dire qu’on n’a pas eu de discussions sur le rôle des institutions. Quand s’est créé SUD-PTT, la première chose qu’on s’est dite est qu’il y avait les élections professionnelles dans trois mois et qu’on devait être capables de s’y présenter. Cela pour deux raisons. La première, c’est que l’une des principales tâches du syndicalisme est la défense immédiate des revendications des salariés. Et si les espaces qui servent à ça ont leurs limites, cela fait partie intégrante du boulot de syndicaliste d’y être. La deuxième raison, c’est que l’élection mesure la représentativité — c’est tout sauf négligeable. En 1989, à nos premières élections, le fait qu’on ait réussi à faire 4,97 % au niveau national, dans une administration de 450 000 personnes à l’époque, et 15 % en région parisienne, a été la confirmation que notre projet syndical avait une assise. Ces voies institutionnelles nous ont donc donné des moyens. Par exemple, tous les locaux de SUD-PTT étaient disponibles grâce à la représentativité qu’on avait acquise — le droit syndical, le téléphone et l’envoi postal gratuit venaient également de là.

Ça nous amène à la question des permanences syndicales et des heures de décharge, en discussion au sein de Solidaires. Il y a des structures qui refusent les temps de permanence complets (SUD-Éducation notamment) et c’est une position qui ne me gène pas du tout. Mais à SUD-PTT, on a vu ça comme un choix d’efficacité : au début, je disais que je ne serai pas permanente mais demi-permanente, puis j’ai vu que ça ne fonctionnait pas : si tu n’es au boulot que la moitié du temps, c’est difficile de faire autre chose à côté et, du reste, ça génère plus de travail pour les collègues. Mais c’est important d’avoir des temps maximums, des limitations. J ’ai souvent dit en rigolant que j’étais une affreuse bureaucrate. Il y a des gens qui ne sont pas permanents syndicaux et qui peuvent être d’affreux bureaucrates aux fonctionnements tout sauf démocratiques et, à l’inverse, j’ai connu des permanents qui ont parfaitement fait vivre la démocratie. Il y a un élément de classe dans cette réflexion : un prof d’université n’a pas forcément besoin d’être permanent mais un facteur ou une factrice n’a pas de marge de manœuvre — il a des petits chefs qui sont là pour le contrôler, il doit être irréprochable et ne peut donc quasiment pas faire de syndicalisme durant son temps de travail. Dans ce cas, sans un temps de permanence, ce sera toujours les mêmes qui auront des responsabilités dans le syndicat — c’est-à-dire ceux qui ont un boulot qui leur permet de faire du syndicalisme sur leur temps de travail. Le risque, après, étant de n’avoir que des « supers » militants ! Or l’un des enjeux du renouvellement est de sortir de ces figures militantes, certes efficaces mais qui ne permettent pas de s’étendre.
« Partis politiques et syndicats ne sont pas la même chose et il n’y a pas de hiérarchie : chacun a sa place ! »
Le patronat français joue sur deux registres. À la fois sur la répression, avec un nombre considérable de licenciements de militants syndicaux, et sur la carotte — en utilisant les acquis en termes de négociation et d’instances syndicales pour imposer ses vues. Depuis des années, on a vu se mettre en place des espaces dits « de négociation » qui accaparent beaucoup le temps des militants, au détriment du terrain. Le regroupement en une seule instance des CHSCT3 et des comités d’entreprises, voire des délégués du personnel, va renforcer complètement la professionnalisation. Les personnes ayant des mandats syndicaux seront moins nombreuses mais auront plus d’heures de réunions. Ce n’est pas nouveau, mais il y a là un coup d’accélérateur. Quand on parle d’institutionnalisation, on parle de la professionnalisation du militant. On peut avoir les meilleurs textes et les meilleures garanties politiques, il faut rester vigilant en permanence : le risque de la professionnalisation est un processus lent, quotidien, subtil. Ce constat nous pousse à rechercher des remparts à cette trop forte institutionnalisation. Lorsqu’on se constitue en syndicat, c’est avec l’idée qu’il faut revenir à un syndicalisme radical et de terrain. De là notre volonté de soutenir les coordinations, les assemblées générales dans les luttes, les consultations, toutes ces pratiques qui ont existé dans l’histoire du syndicalisme. Lors de la réforme des PTT, nous avions décidé de distribuer l’intégralité du texte de la réforme avec nos commentaires en marge : ça ne s’était jamais fait. Cela signifiait donner aux gens la possibilité de former leur avis : ça a été un atout de poids pour mobiliser dans les bureaux de poste.
Notre projet syndical essaie d’allier une ligne politique radicale et combative en s’appuyant sur les mobilisations avec des valeurs fortes. Lorsqu’il s’agit de services publics, de lutte contre la précarité, contre le racisme et le machisme, pour la Sécurité sociale, ce n’est rien d’autre que de la politique. Nous avons rejeté dès le début cette idée que le parti politique donnait la vision générale et que le syndicat faisait la tambouille des revendications quotidiennes : partis politiques et syndicats ne sont pas la même chose et il n’y a pas de hiérarchie : chacun a sa place ! La décennie mitterrandienne, malgré quelques mesures progressistes avant le tournant austéritaire de 1983, est marquée par un affaiblissement très important du mouvement syndical, toutes tendances confondues. Une forte institutionnalisation a conduit — consciemment ou non — à s’en remettre totalement au gouvernement socialiste, avec l’idée que c’était notre camp qui gouvernait et qu’il ne fallait donc pas le gêner avec des luttes ! Je caricature à peine… C’était une décennie où l’on ne pouvait plus se dire anticapitaliste, où le journal Libération titrait « Vive la crise ! » et où un Bernard Tapie devenait ministre ! Mais il y a bien sûr d’autres raisons à ce recul du syndicalisme, et notamment la perte, avec la désindustrialisation, de gros bastions de l’industrie comme la sidérurgie.

Dans les statuts fondateurs de Solidaires est inscrite l’idée que ce syndicat a pour objet de rassembler mais que « ce rassemblement n’est pas une fin en soi, c’est une étape pour être plus fort.e.s ensembles ». Comment comprendre cette phrase ?
Le syndicat est d’abord un outil, ce n’est pas une fin en soi. La CFDT était un outil qui a perdu, à nos yeux, son utilité lorsqu’ils nous ont viré ; on a fait un autre outil ! Mais si, un jour, ce que j’appelle le syndicalisme de lutte — dans lequel je mets Solidaires, une partie de la FSU et la CGT — pouvait se rassembler dans un cadre commun, ce serait plus intéressant en termes de rapports de force . Mais les conditions ne sont à l’heure qu’il est pas du tout remplies. C’est une idée de la CGT, d’ailleurs : ils veulent un « syndicalisme rassemblé ». Il y a différents types de syndicalisme et il faut assumer ces différences ; en tout cas, je continue de penser que le syndicalisme est un outil irremplaçable : il va donc falloir trouver un moyen de faire vivre un syndicalisme qui ne parle pas à la place des salariés, qui est à leur écoute et prend en compte la situation de travail.