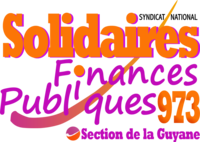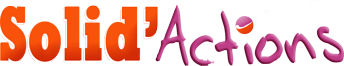Actualités
Adhérents, adhérentes,
Un projet de modification du calendrier de la campagne de mutation a été présenté le 24 novembre 2025 lors du Groupe de Travail LDG mobilités.
La direction générale souhaitait fixer un calendrier allant du 19 décembre 2025 au 9 janvier 2026, soit en plein pendant les congés de fin d'année, malgré l'opposition unanime des organisations syndicales et des capistes nationaux !
Un scandale ! Après notre demande auprès de la Direction Générale, celle-ci a modifié le calendrier.
La campagne d'élaboration des vœux aura donc lieu du 29 décembre 2025 au 16 janvier 2026
Voilà qui est bien plus raisonnable, et permettra aux agent·es, aux militant·es, ainsi qu'aux collègues des bureaux RH de gérer bien plus sereinement cette période si importante dans la vie des collègues.
Si vous souhaitez des renseignements sur le mouvement national, vous pouvez contacter le bureau mutation :Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
ou la section locale : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser."
Bonjour à toutes et tous,
Vous trouverez ci-joint la déclaration liminaire qui a été lue au Comité Social d'Administration Local exceptionnel qui s'est tenu le jeudi 13 novembre 2025.
Bonne lecture.
![]() Liminaire_Soildaires_FiP_Guyane_-_CSAL_du_13_novembre_2025.pdf
Liminaire_Soildaires_FiP_Guyane_-_CSAL_du_13_novembre_2025.pdf
Vos élu.es du Comité Social d'Administration Local
Vanessa DUPUY-DRAYTON
Jonathan MARTIAS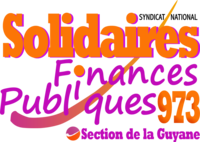

Suspension de la procédure d'affiliation en prévoyance (GMF) en raison d'une faille de sécurité
Lors de la réunion de la commission paritaire de pilotage et de suivi de ce vendredi matin, l'administration a annoncé la suspension de la procédure d'affiliation en prévoyance (GMF) en raison de la découverte d'une faille de sécurité sur la plateforme d'affiliation. Il n'est donc plus possible de s'affilier depuis ce matin et ce, jusqu'à nouvel ordre.
A ce stade, aucune intrusion n'aurait été identifiée. Un audit de sécurité est en cours et devrait rendre ses conclusions jeudi prochain. En fonction de ses résultats et des correctifs à apporter, un message informera les agentes et les agents de la reprise de la procédure.
La date limite d'affiliation et de dispense en prévoyance prévue le 30 novembre est donc reportée vraisemblablement jusqu’à fin décembre 2025.
Solidaires finances a dénoncé l'amateurisme de la GMF Vivinter, ce problème s'ajoutant aux nombreux dysfonctionnements rencontrés avec cet opérateur. Un compte rendu de la CCPS sera disponible la semaine prochaine faisant état des interventions de Solidaires Finances et des réponses du ministère, notamment sur la question du refus d'adhésion aux options en prévoyance opposé aux personnes en arrêt maladie ou en mi-temps thérapeutique.
N'oublions pas Mayotte
Presque un an après le passage du cyclone Chido ayant dévasté Mayotte, la situation est encore extrêmement difficile pour l'ensemble de la population et pour les agentes et agents de la DGFiP. Solidaires Finances Publiques interpelle une nouvelle fois la Directrice Générale concernant les conditions de travail extrêmement dégradées.
Madame la Directrice générale,
Solidaires Finances Publiques revient vers vous afin de refaire un point sur la situation de Mayotte.
Depuis notre interpellation du 17 février, beaucoup de sujets ne sont toujours pas réglés.
Lors de la dernière assemblée générale de notre section syndicale de Mayotte, nous avons eu l’occasion de faire le tour des services et constater que les travaux des réparations post Chido ont du mal à avancer. En effet, sur le site de Boboka, des ouvrants sont fragilisés, un carton remplace la vitre brisée d’une porte elle-même bloquée par une solution de fortune qui ne garantit plus la sécurité du bâtiment. Actuellement, les travaux de réfection des cloisons intérieures sont en cours mais l’utilisation de peinture acrylique en zone fermée occasionne désagréments et maux de tête pour de nombreux collègues sur place.
Le site de Mariaze quant à lui n’est toujours pas hors d’eau alors que la région va débuter la saison humide. Dans certains bureaux, les collègues sont contraints de couvrir tous les soirs leurs bureaux avec des bâches, et protéger les matériels informatiques et bureaux en cas de pluie. Site qui est régulièrement inondé après chaque forte pluie. Cette situation n’est plus acceptable, les collègues ont du mal à comprendre pourquoi dans d’autres ministères les travaux avancent beaucoup plus rapidement.
Alors que trois offres sérieuses ont été déposées suite à l’appel d’offre des travaux, aucune validation n’a encore été prononcée au niveau national. Nous réaffirmons qu’il est urgent que ce dossier avance car après bientôt un an après le passage de Chido rien n’est réglé, bien au contraire.
Même si les collègues de Mayotte ont prouvé leur engagement coûte que coûte pour maintenir l’exercice des missions et la présence de notre service public, leur résilience commence à atteindre les limites du supportable.
En effet, les soucis du cadre professionnel ne sont pas leur seule préoccupation et de nombreuses difficultés se cumulent, dégradant un peu plus la vie quotidienne et les conditions de travail des agentes et agents.
Les travaux de réfection des réseaux d’eau potable nécessaires occasionnent de nombreuses coupures, et ce, sur une période prolongée. Ce mois-ci, dans un grand secteur de Grande Terre, la population n’aura accès à l’eau qu’un jour sur quatre ce qui pose de gros problèmes d’hygiène et d’accès aux sanitaires, que ce soit chez eux ou dans les locaux de l’administration. Et les réserves d’eau seront insuffisantes pour garder les espaces dans un état propre sur plusieurs jours.
Une autre difficulté qui affecte les collègues touche la scolarité de leurs enfants. En effet, l’Éducation Nationale a mis en place des classes « tournantes » puisque de nombreuses écoles ne sont toujours pas accessibles. Certains enfants n’ont cours que deux demi-journées par semaine, ce qui est aberrant dans un département français.
La question des transports et de l’insécurité reste d’actualité. Même si les routes ont bien été dégagées, les collègues du sud de l’île mettent toujours autant de temps pour se rendre à Mamoudzou. La présence des forces de l’ordre n’empêche pas les agressions ou les vols à l’arraché. Solidaires Finances Publiques réaffirme qu’au regard des difficultés de transport et d’insécurité, une étude doit être engagée sur la possibilité d’implantation de Boboka 2 au sud de l’île, ce qui aurait, pour les collègues, plus de sens que de tout centraliser sur Mamoudzou.
Même si ces questions dépendent du ministère, nous réitérons la demande d’une présence à temps plein et pérenne d’une ou deux assistantes sociales sur Mayotte. La présence d’un ou d’une psychologue est aussi une urgence et une nécessité pour de nombreux personnels de la DGFiP fortement ébranlés par Chido.
Solidaires Finances Publiques tient à attirer votre attention sur le volet social local qui est totalement délaissé. Le positionnement sur le département de La Réunion du médecin de prévention et de l’assistante sociale est une très mauvaise solution, très mal vécue par les collègues de la DGFiP.
Nous revenons également sur l’égalité des droits où rien n’a évolué. Les tensions fortes existent toujours entre collègues mahorais et collègues métropolitains. Afin d’y remédier et de mettre fin à une inégalité de traitement, Solidaires Finances Publiques réitère sa demande pour que l’indemnité de logement versée aux seuls métropolitains soit également versée aux agentes et agents mahorais.
Nous restons disponibles pour suivre et avancer sur ce dossier qui, pour nous, reste une priorité.
Sandra Demarcq
Secrétaire Générale de Solidaires Finances Publiques
Page 2 sur 25