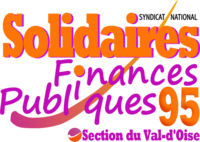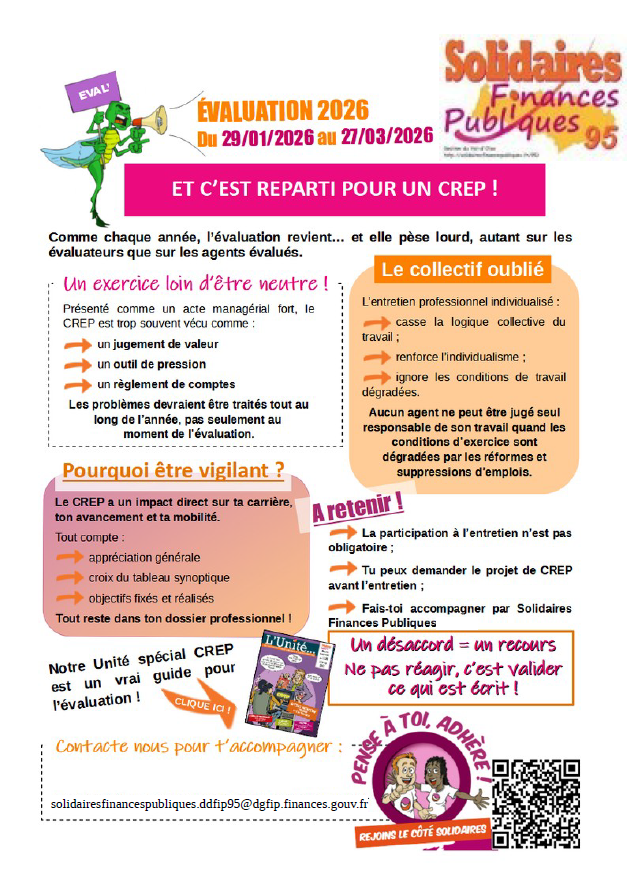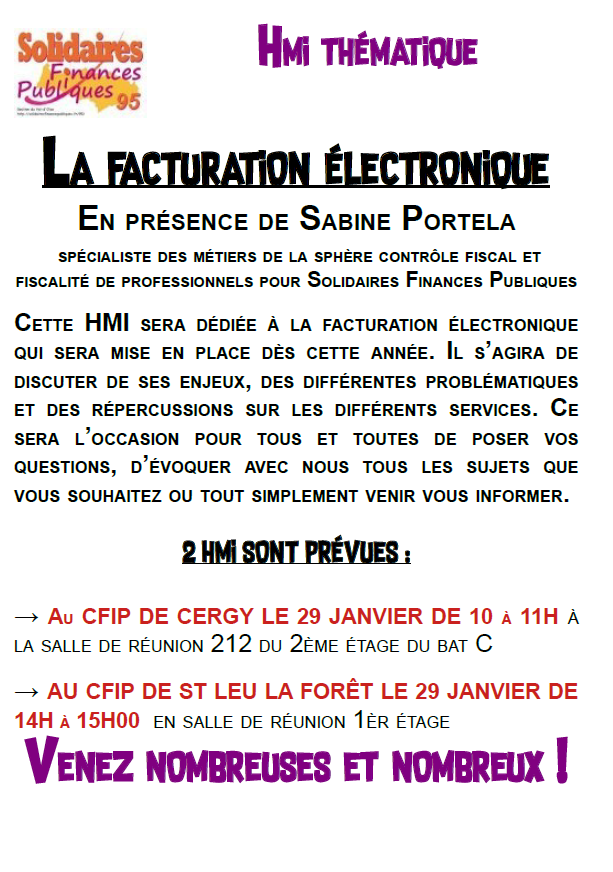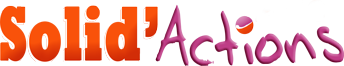Actualités
La campagne d’entretien professionnel 2025 va être lancée ce 29 janvier 2026. À partir de cette date et ce jusqu’au 27 mars 2026, vous serez toutes et tous (quelle que soit votre catégorie A+,A, B, C, titulaire ou contractuel) convoqués pour un entretien (vous n’avez pas l’obligation d’y aller) avec votre évaluateur qui donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu d’évaluation professionnelle ( CREP).
Ce CREP devient un élément essentiel de la poursuite de votre carrière, que ce soit pour les mutations (multiplication des postes à profil et mise en concurrence entre agents ) ou les promotions (tableau d’avancement, liste aptitude…).
Solidaires Finances Publiques 95 organise des "heures mensuelles d'information" (HMI) sur l'évaluation professionnelle pour vous informer, vous conseiller mais aussi vous exposer les voies de recours.
| SITES | DATES | HORAIRES |
| CFIP ST LEU LA FORËT | 09/02/26 | 10H00 |
| CFIP ERMONT | 09/02/26 | 14H00 |
| CFIP CERGY | 10/02/26 | 10H00 |
| CERGY PREFECTURE/VOA | 10/02/26 | 14H30 |
| SGC ISLE-ADAM | 11/02/26 | 10H00 |
| CFIP GARGES | 11/02/26 | 14H00 |
| T.HOSPITALIERE PONTOISE | 12/02/26 | 10H00 |
| CFIP ARGENTEUIL | 12/02/26 | 14H00 |
| PAIERIE DEPARTEMENTALE | 17/02/26 | 10H00 |
| SGC MAGNY EN VEXIN | 17/02/26 | 14H30 |
| SGC MONTMORENCY | 19/02/26 | 10H00 |
Page 1 sur 40